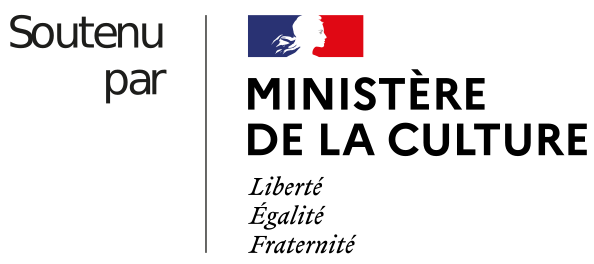Les propos ou comportements à connotation sexiste sont désormais pleinement intégrés à la définition du harcèlement sexuel au travail.
La réforme était attendue et avait été l’objet d’un quasi consensus lors des débats parlementaires autour de la loi santé, adoptée le 2 août dernier. Le harcèlement est désormais matérialisé dès lorsqu’il est subi par le salarié et non pas lorsqu’il est imposé par le ou les auteurs.
Selon, l’article 1 de la loi du 2 août 2021 pour renforcer la prévention de la santé au travail, constituent le harcèlement :
« Des propos ou comportements à connotation sexuelle « ou sexiste» répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ».
Abonnez-vous et bénéficiez d’articles en illimité tous les mois ou à la carte.
Pour lire cet article en entier, vous devez posséder Abonnement annuel (ancien), Abonnement mensuel (ancien), Abonnement mensuel or Abonnement annuel.
Déjà membre ? Merci de log in.
La suite de cet article est réservée aux abonnés et en achat à la carte.
Déjà abonné ? Merci de se connecter.