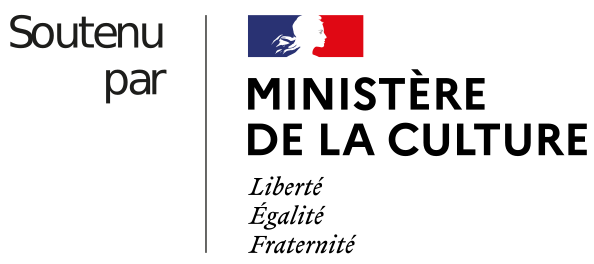Les plus jeunes citoyens sont au cœur des affaires judiciaires liées au changement climatique, révèle un rapport publié par l’ONU.
Le nombre d’affaires judiciaires climatiques a plus que doublé entre 2017 et 2022 indique un rapport du programme des Nations Unies pour l’environnement, publié le 27 juillet dernier.
En 2017, 884 dossiers de ce type étaient comptabilisés contre 2 180 en 2022.
La justice climatique est en devenir et les plus jeunes citoyens comptent bien l’utiliser pour faire avancer les États et entreprises.
Abonnez-vous et bénéficiez d’articles en illimité tous les mois ou à la carte.
Pour lire cet article en entier, vous devez posséder Abonnement annuel (ancien), Abonnement mensuel (ancien), Abonnement mensuel or Abonnement annuel.
Déjà membre ? Merci de log in.
La suite de cet article est réservée aux abonnés et en achat à la carte.
Déjà abonné ? Merci de se connecter.
Abonnez-vous et bénéficiez d’articles en illimité tous les mois ou à la carte.
Populaire