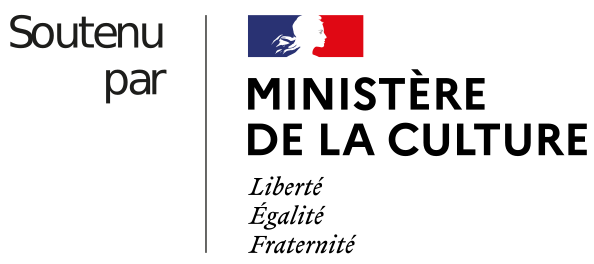La première phase de négociations pour élaborer un traité international contre la pollution plastique s’est achevée, le 2 décembre, mettant en avant un nécessaire cadre juridique.
Environ 460 millions de tonnes de plastiques ont été produites en 2019 dans le monde, générant 353 millions de tonnes de déchets dont moins de 10 % sont actuellement recyclées, selon les dernières estimations de l’OCDE. Et pour cause, la réglementation sur le plastique et la gestion de ces déchets est propre à chaque État.
C’est pourquoi, le 2 mars dernier, l’Assemblée pour l’environnement de l’ONU a adopté une résolution créant un « comité intergouvernemental de négociation » chargé d’établir un traité international contre la pollution plastique.
La première réunion de ce comité, qui s’est déroulée du 28 novembre au 2 décembre en Uruguay, a amorcé un cadre juridique aux négociations.
Abonnez-vous et bénéficiez d’articles en illimité tous les mois ou à la carte.
Pour lire cet article en entier, vous devez posséder Abonnement annuel (ancien), Abonnement mensuel (ancien), Abonnement mensuel or Abonnement annuel.
Déjà membre ? Merci de log in.
La suite de cet article est réservée aux abonnés et en achat à la carte.
Déjà abonné ? Merci de se connecter.